En plus de son effet négatif sur le paysage urbain, qui donne une image peu reluisante de nos villes, les déchets maintenus à l’air libre et à proximité des équipements socio-collectifs urbains comme les marchés, voire les hôpitaux, présentent des risques sanitaires élevés sur la population.
L’évolution du taux d’urbanisation du Cameroun suit la tendance mondiale à la croissance accélérée de la population urbaine. Celle-ci est passée dans notre pays de 28,5% en 1976 et 37,8% en 1987 à 52% en 2010 (BUCREP – RGPH 1976, 1987, 2005 et projections), avec une estimation de 59,4% en 2022 (BUCREP). Cette urbanisation rapide n’est pas uniquement démographique ; elle est également spatiale. En effet, du fait des lacunes dans la planification, se traduisant notamment par l’occupation anarchique du sol, le Cameroun rejoint la tendance observée dans les pays en développement dans lesquels « la superficie des villes augmente plus vite que leur population ». En moyenne, la surface des terres qu’elles occupent augmente deux fois plus rapidement que le nombre de leurs habitants ». Cet étalement urbain non maîtrisé (l’on parle aussi de fragmentation des villes), en plus de la pression foncière accrue, force les villes à réaliser des investissements lourds pour répondre aux besoins en services urbains, dont la mobilité et la gestion des déchets.
En effet, la croissance urbaine accélérée induit mécaniquement celle de la production des déchets. La ville de Yaoundé, par exemple, connaît une augmentation de la production des déchets de l’ordre de 20 000 tonnes par an. Cependant, en dépit des actions entreprises par les pouvoirs publics, le sous-secteur de la gestion des déchets solides, dans ses composantes institutionnelle, financière, technique et opérationnelle, se révèle inefficace pour gérer cette donne socio-démographique.
Les faiblesses du système actuel se caractérisent par des lacunes dans la structuration de la pré-collecte, l’obsolescence du dispositif technique de gestion des déchets (collecte, transport, traitement) qui fait face à l’absence d’infrastructures, des efforts de valorisation demeurant embryonnaires, des conflits de compétences persistants entre les acteurs institutionnels et un schéma de financement inadéquat, s’agissant aussi bien de la faiblesse des ressources disponibles que des présentateurs des mécanismes de contractualisation existants. Ces lacunes se traduisent finalement par un faible taux de collecte des déchets : il est de 45% à Yaoundé pour une production estimée à environ 3000 tonnes/j.
Il en résulte la prolifération des tas sauvages dans les rues, l’accumulation des ordures aux points de collecte, la multiplication des décharges non contrôlées.
L’impact est également environnemental dans la mesure où les déchets maintenus à l’air libre deviennent émetteurs de gaz à effet serre, dont le méthane qui est l’un des plus nocifs pour l’atmosphère. Dans ce registre de l’environnement, l’on constate le développement des pratiques telles que le brûlage des déchets qui présentent en outre des risques d’incendies. Il convient enfin de relever l’obstruction des systèmes de drainage par les déchets solides, notamment les bouteilles plastiques, ce qui accroît les risques d’inondations dans les villes.
Les réflexions menées sur cette problématique montrent que le sous-secteur des déchets, en particulier ménagers et assimilés, fait face à de lourdes lacunes et contraintes structurelles, à la fois institutionnelles, techniques, opérationnelles et financières, qui nécessitent d’être traitées en profondeur en vue de sa restructuration et, incidemment, de la résorption durable du problème de l’insalubrité des villes.
Certes, plusieurs solutions ont été préconisées par diverses instances de réflexion. Quelques-unes ont abouti à l’adoption de nouveaux dispositifs, parmi lesquels l’on peut citer, s’agissant du financement, les droits d’accises. Cependant, la difficulté persistante à les mobiliser suggère également de revisiter ou de compléter le dispositif. Il en est de même du cadre institutionnel qui confie la gestion des déchets aux Communautés urbaines et aux Communes, mais avec toutefois des zones de conflits soulignés par les acteurs locaux et la non-implication des Conseils Régionaux (Cf. Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées).
Afin de poser les jalons de ce processus de révision, et en capitalisant les pistes de solutions identifiées au cours des réflexions antérieures, il convient aujourd’hui d’élargir le cadre de consultation à l’ensemble des acteurs de l’hygiène, de la gestion des déchets et de l’assainissement des villes.
C’est dans cette perspective participative et inclusive que le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain et le Ministère de la Décentralisation et du Développement localorganisent les Etats généraux de la gestion des ressources en déchets urbains. Ces assises sont conçues comme un cadre participatif d’examen des contraintes de mise en œuvre des dispositifs institutionnels, techniques et financiers formulés antérieurement, en vue de co-construire des solutions durables de gestion des déchets en milieu urbain, en particulier ménagers et assimilés.
Cette concertation nationale s’arrime d’une part aux directives données au Gouvernement par le Chef de l’Etat, S.E.M. Paul BIYA lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2023. Le Président de la République instruisait le Gouvernement au sujet de l’état d’insalubrité des villes en ces termes : « Face à la dégradation de la situation en la matière, j’ai prescrit au Gouvernement de trouver en urgence, une solution pérenne au problème du ramassage des ordures ménagères dans nos villes, en collaboration avec les Communes et les Communautés Urbaines ».
D’autres parts elle s’aligne aux objectifs définis par les principaux documents de stratégie de développement durable en vigueur au Cameroun, notamment :
- Les Objectifs de Développement Durable (ODD) dont (i) la cible 11.6 vise à réduire l’impact environnemental négatif des villes par habitant, en accordant une attention particulière à la gestion des déchets municipaux (ii) et la cible 12.5 vise à réduire considérablement la production de déchets par la prévention et la valorisation ;
- La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND 30) qui préconise, d’une part, la modernisation des villes et la construction des infrastructures d’assainissement de base, et d’autre part, la réforme du cadre légal et réglementaire de la gestion des déchets centrée sur la libéralisation du marché et la pénalisation de l’insalubrité ;
- La Politique Urbaine Nationale du Cameroun (PUN) qui préconise la réforme de la politique de gestion des déchets municipaux.
Autour de l’ambition de changer de paradigme pour voir dans les déchets une ressource pour le développement économique et social des villes, ces États généraux visent à formuler, de manière inclusive et participative, une Feuille de route engageant toutes les parties prenantes sur des mesures et des initiatives couvrant la chaîne de gestion des déchets : production par les ménages et les entreprises, pré-collecte, collecte, traitement, valorisation. L’accent sera mis sur les propositions de révision juridique et institutionnelle à mettre en œuvre de manière diligente, ainsi que sur des solutions opérationnelles en matière d’infrastructures, de financement du système de gestion des déchets et d’appui à l’économie circulaire.









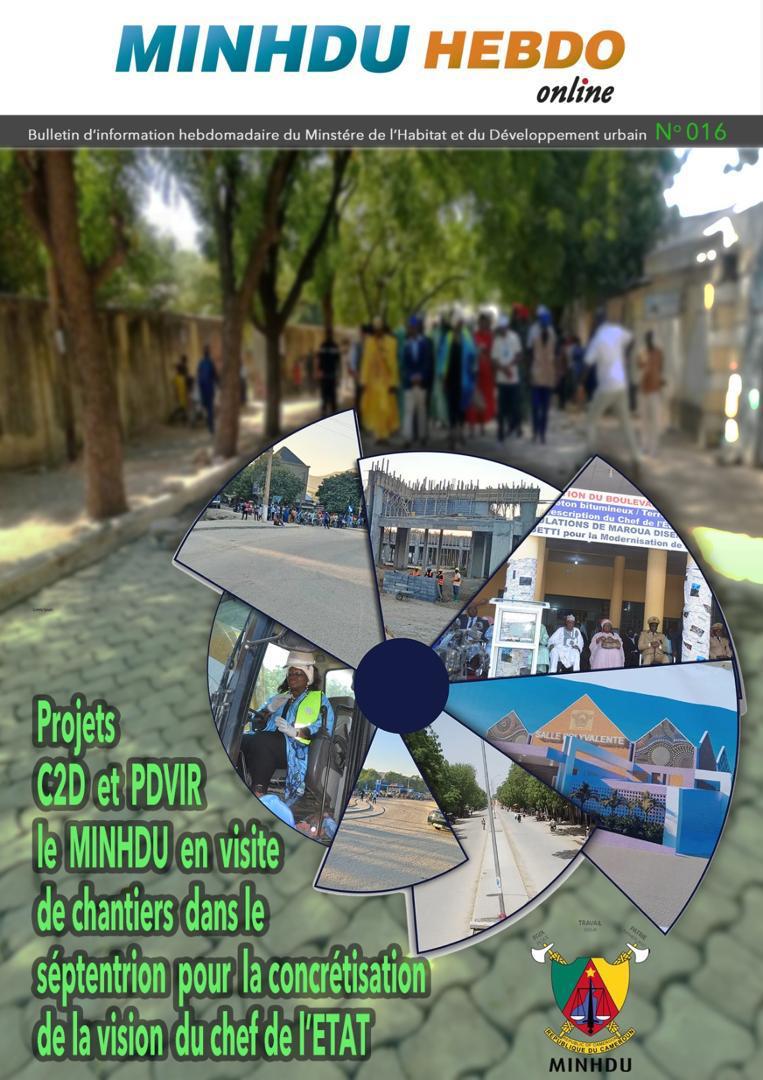
0 commentaires